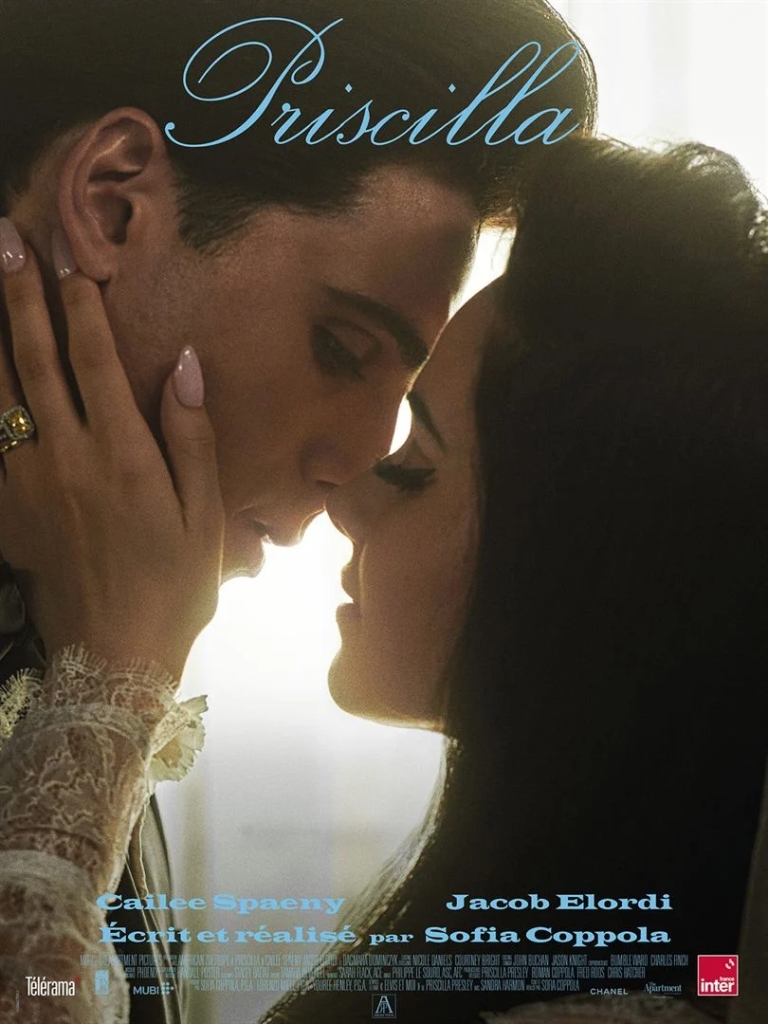De Sean Durkin
Avec Zac Efron, Harris Dickinson, Jeremy Allen White
Chronique : The Iron Claw raconte l’histoire de la famille Von Erich qui marqua l’histoire du catch américain au début des années 80 au prix d’un destin tragique.
Le film de Sean Durkin ne se veut pas tant une entreprise de vulgarisation d’un sport dont l’engouement populaire reste un mystère pour moi et dont j’ai définitivement le plus grand mal à comprendre le principe (c’est tout arrangé, non ?…), mais le portrait en clair-obscur d’un clan tout dédié à une cause.
Le cœur de The Iron Claw, c’est véritablement cette fratrie solidaire et soudée autour d’un objectif commun, satisfaire à tout prix l’ambition démesurée que leur père place en eux.
Ce personnage monstrueux, incarné avec autorité par Holt McCallany (Midhunter) est au centre du récit. Figure tyrannique à qui on ne dit jamais non, il inspire autant de respect que de terreur à ses quatre fils, leur imposant de réussir là où lui à échouer. N’auront grâce à ses yeux que ceux qui parviendront à devenir champion du monde de catch, titre qu’on lui a, évidemment, injustement refusé quand il pratiquait le catch. Il n’hésite pas à les pousser à s’entrainer jusqu’à leurs dernières forces, à challenger leurs compétences, leur envie et leur loyauté envers lui. Il va jusqu’à insidieusement les mettre en concurrence en édictant un classement de ses fils préférés, quitte à ébranler la solidité de leur lien. Mais l’amour fraternel semble toujours au-dessus de tout et c’est ce qui rend cette histoire aussi belle que funeste.
Car The Iron Claw s’apparent plus à une grande tragédie qu’à un simple biopic. Dès le départ, la voix de Kevin, l’ainé des Von Erich (Zach Efron, émouvant colosse surmusclé tout en peine intériorisée) annonce un drame inéluctable, une malédiction familiale qui va s’abattre sur eux. La mort plane, certes, mais la seule malédiction qu’on voit à l’œuvre est celle de l’emprise paternelle, de ses névroses et de ses obsessions projetées sur chacun de ses fils et qui ne vont cesser de les tourmenter.
C’est dans l’étude des liens et des rapports de force entre chaque entité de cette famille que le film de Sean Durkin tire sa force et sa singularité. L’amour que se porte les quatre frères, leur complicité sont évidents mais leur solitude face aux exigences toxiques du père pèse indéniablement sur leur relation alors que leur mère préfère ne rien voir, ne rien savoir, refusant de prendre parti, refoulant ses propres angoisses et plaçant ses enfants entre les mains de Dieu (géniale Maura Tierney, comme d’habitude).
La mise en scène rend parfaitement hommage à l’esthétisme des 80s’, des décors aux retransmissions télé, en passant par la musique, et les coupes de cheveux (ah les coupes de cheveux), tout est fait pour nous plonger dans cette fresque familiale dure, tendre et tragique.
A travers le portrait de la famille Von Erich, Sean Durkin questionne les codes virilistes de l’époque. The Iron Claw renvoie une certaine image de l’Amérique, celle des apparences et du statut. Les corps des quatre frères sont musclés, meurtris, sculptés pour réussir, les dents sont serrées et les larmes retenues, mais les cœurs restent, quoiqu’en pense leur père, sensibles.
Synopsis : Les inséparables frères Von Erich ont marqué l’histoire du catch professionnel du début des années 80. Entrainés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. Entre triomphes et tragédies, cette nouvelle pépite produite par A24 est inspirée de leur propre histoire