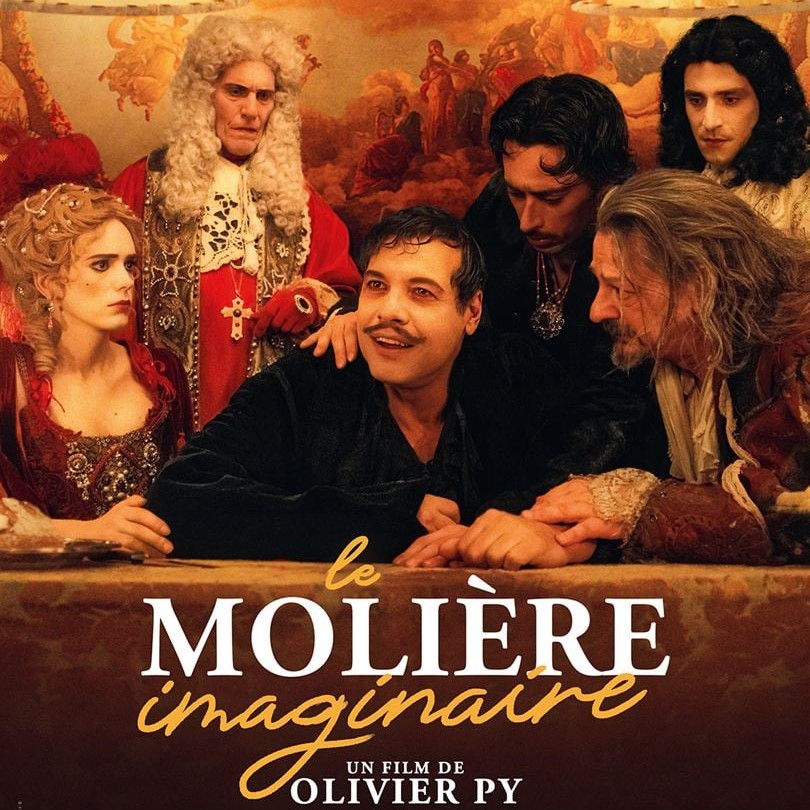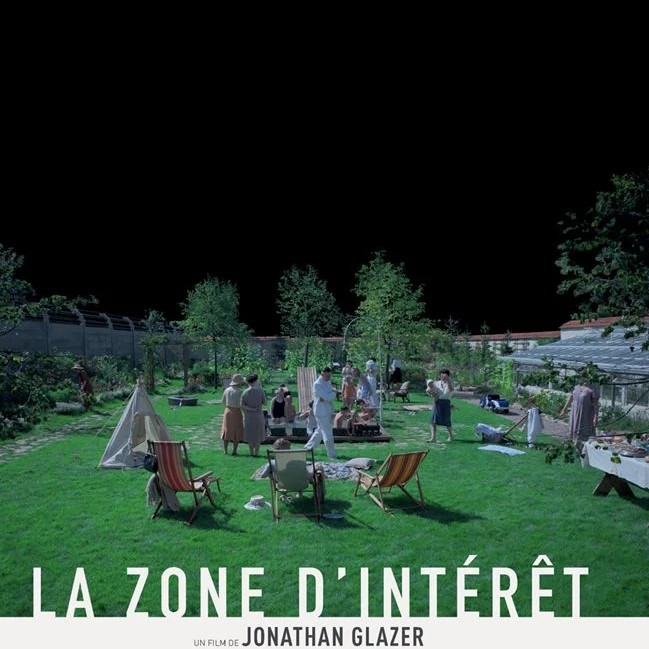De Andrew Haigh
Avec Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bel
Chronique : Drame fantastique vaporeux et délicate romance gay, Sans Jamais nous Connaître nous embarque dans un voyage singulier entre passé et présent.
Alors qu’il fait la connaissance de Harry avec qui il va débuter une relation amoureuse qu’il n’attendait plus, Adam retrouve la maison de son enfance. A l’intérieur semblent toujours y vivre ses parents, en tout point identiques à ce à quoi ils ressemblaient le jour de leur mort, quand il avait 11 ans.
C’est un drôle de film que nous livre Andrew Haigh, un film de fantômes d’une sourde mélancolie mais aussi la rencontre de deux solitudes.
Cette projection mentale qui ne nous sera jamais expliquée donne à Adam l’occasion de faire son deuil, à la fois de ses parents mais aussi de tout ce qu’il n’a pas pu leur dire. Haigh fait preuve d’une grande tendresse lorsqu’il confronte son personnage au souvenir de ses parents, rendant tangibles, presque crédibles ces retrouvailles de l’au-delà. Le réalisateur nous offre des moments aussi touchants qu’étranges lorsque ce couple étreint cet enfant plus âgé qu’eux…Adam peut finalement faire ce coming-out dont il se sentait privé. Sans doute pour enfin vivre qui il est vraiment.
L’homosexualité d’Adam est d’ailleurs au cœur du film. Haigh a toujours su peindre cette communauté avec sincérité et réalisme (Week-end, la série Looking). On retrouve cette authenticité lorsqu’il développe l’histoire d’amour entre Adam et Harry. Il fait preuve de beaucoup de justesse lorsqu’il évoque l’évidente connexion physique et sentimentale entre les deux hommes.
Le fond est puissant donc, mais la forme interroge. On voit ce que Haigh cherche à dire à travers ce film de revenants mélancolique mais quelque chose bloque.
L’ultra sophistication de la mise en scène dessert le propos et donne l’impression que le réalisateur a fini par privilégier l’apparence. La photographie, très chiadée, joue constamment avec les lumières, les clair-obscur et les effets stroboscopiques. Les dialogues, très nombreux et chuchotés pour la plupart, sont trop littéraires pour qu’on y croit tout à fait. Ils expliquent tout sans laisser de place à l’interprétation. Mais l’élément le plus rédhibitoire est cette musique qu’on dirait tirée d’une séance de méditation. Elle en a en tout cas l’effet soporifique et assomme le récit qui n’en avait pas besoin.
Si Paul Mescal, tout en nuance et séduction sauvage est très convaincant en amant maudit, Andrew Scott peine à vraiment émouvoir dans ce rôle nécessitant plus de retenu que ceux qu’il a l’habitude d’interpréter. En surjouant le côté larmoyant et désabusé, il agace plus qu’il n’émeut.
Sans Jamais nous Connaître suscitait chez moi une attente sans doute démesurée. Mais Haigh semble avoir été pris au piège de l’exercice de style qui étouffe le sens et l’émotion. Son propos aurait sans doute été plus fort expurgé des tics de cinéma indé américain. Il m’a perdu en route…
Synopsis : A Londres, Adam vit dans une tour où la plupart des appartements sont inoccupés. Une nuit, la monotonie de son quotidien est interrompue par sa rencontre avec un mystérieux voisin, Harry. Alors que les deux hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de son passé et retourne dans la ville de banlieue où il a grandi. Arrivé devant sa maison d’enfance, il découvre que ses parents occupent les lieux, et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort, il y a plus de 30 ans.